
Cigars and Cinema
Quand la fumée révèle l'âme des personnages
29/05/2025
Une icône cinématographique intemporelle
Au cinéma, aucun accessoire n’est jamais laissé au hasard. Le cigare, plus qu’un simple objet, devient un véritable langage cinématographique, un prolongement de l’âme du personnage qui transcende les mots et les gestes. Contrairement à la cigarette, souvent associée à la nervosité ou à l’habitude sociale, le cigare impose sa présence : il ralentit le temps, sculpte l’espace et révèle des caractères complexes.
Cette puissante charge symbolique fait du cigare un outil narratif privilégié des cinéastes depuis les premiers âges du septième art. Qu’il évoque la puissance, la décadence, le raffinement ou la transgression, il devient instantanément révélateur de l’univers mental de celui qui le porte à ses lèvres.

Le cigare comme signe de pouvoir et de transgression
Les maîtres du crime organisé
L’histoire du cinéma a forgé une association indéfectible entre le cigare et l’exercice du pouvoir, particulièrement dans sa dimension la plus sombre. Tony Montana, incarné par Al Pacino dans Scarface (1983), illustre parfaitement cette symbolique. Ses cigares cubains accompagnent son ascension fulgurante dans l’empire de la drogue, devenant les témoins silencieux de sa transformation d’immigrant désespéré en baron tout-puissant. Chaque bouffée semble aspirer un peu plus de pouvoir, chaque volute de fumée dessine les contours de son empire criminel.
Dans le même registre, Marlon Brando dans Le Parrain (1972) utilise son cigare comme un sceptre invisible. Don Vito Corleone ne gesticule jamais : il se contente de tirer lentement sur son cigare, et ce simple geste impose le silence, commande le respect, scelle les destins. Le cigare devient l’extension naturelle de son autorité patriarcale, un objet qui matérialise sa capacité à contrôler le temps et l’espace autour de lui.
L’univers impitoyable de la finance
Gordon Gekko, magistralement interprété par Michael Douglas dans Wall Street (1987), transpose cette symbolique du pouvoir dans l’univers de la haute finance. Son cigare cubain, qu’il savoure dans son bureau aux baies vitrées donnant sur Manhattan, devient l’emblème d’une domination économique sans limite. Chaque cigare allumé ponctue une acquisition, célèbre une victoire sur un concurrent, matérialise sa philosophie du “Greed is good”. L’objet devient ici métaphore de la consommation ostentatoire et de l’hubris capitaliste.
Le cigare, accessoire de virilité… mais pas uniquement
L’Ouest sauvage et la masculinité brute
Clint Eastwood a révolutionné l’usage du cigare dans le western. Dans la trilogie du Dollars de Sergio Leone, son cigare sec, coincé entre les dents, devient une arme psychologique autant qu’un totem de survie. Il ne le fume pas avec délectation : il le mâchonne, le malmène, en fait un prolongement de sa détermination implacable. Cette approche brutale du cigare reflète un Far West sans romantisation, où la masculinité s’exprime par la retenue et la menace sourde plutôt que par l’explosion de violence.
Les années 1980 ont porté cette esthétique de la masculinité à son paroxysme avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Leurs personnages utilisent le cigare comme un trophée de guerre, un marqueur de victoire sur l’adversité. Dans Predator (1987), Schwarzenegger allume son cigare dans la jungle hostile, transformant cet instant en déclaration de domination sur un environnement qui voudrait l’anéantir.
Subversion et émancipation féminine
Mais le cigare n’est pas resté l’apanage exclusif de la masculinité. Whoopi Goldberg, dans ses performances scéniques et cinématographiques, s’empare de cet attribut traditionnellement masculin pour questionner les codes du genre et de la race. Son cigare devient un geste d’émancipation, une revendication d’égalité dans l’espace public.
Sigourney Weaver, notamment dans Working Girl (1988), utilise le cigare comme un outil de transgression sociale. Quand son personnage s’octroie ce privilège habituellement réservé aux hommes de pouvoir, elle opère une subversion silencieuse mais radicale des hiérarchies établies. Angelina Jolie, dans certaines de ses apparitions publiques et campagnes photographiques, prolonge cette tradition de détournement subversif.
Cigare et comédie : quand la fumée devient un gag
Les maîtres du rire
Groucho Marx a fait du cigare son alter ego comique. Plus qu’un accessoire, c’est devenu sa signature visuelle, au même titre que sa moustache postiche et ses sourcils froncés. Chez lui, le cigare ponctue chaque réplique, souligne chaque sarcasme, devient un bâton de chef d’orchestre dirigeant la symphonie du rire. Il le brandît, le fait tournoyer, s’en sert pour pointer ses victimes ou marquer ses pauses, transformant chaque scène en ballet comique.
L’animation et l’absurde
L’univers du dessin animé s’est emparé du cigare comme d’un formidable ressort visuel. Dans Tom et Jerry, le cigare devient souvent l’instrument de la catastrophe : il explose, transforme les personnages en créatures noircies, déclenche des réactions en chaîne dévastatrices. Les Looney Tunes exploitent ces mêmes codes, faisant du cigare un détonateur d’absurdité.
Les Simpson prolongent cette tradition en conférant au cigare une dimension satirique. Quand Homer allume occasionnellement un cigare, c’est pour singer les codes de la réussite sociale, révélant par contraste son inadéquation fondamentale avec cet univers de pouvoir qu’il rêve d’intégrer.
Le cigare, témoin d’une époque et d’un style
L’âge d’or du film noir
Les années 1940 et 1950 ont vu naître l’esthétique du film noir, univers de pénombre et d’ambiguïté morale où le cigare trouve naturellement sa place. Dans Le Faucon maltais (1941), Humphrey Bogart façonne Sam Spade en détective désabusé dont le cigare matérialise la lassitude existentielle. Chaque volute de fumée semble porter le poids d’une société corrompue, chaque bouffée révèle la fatigue d’un homme confronté aux noirceurs de l’âme humaine.
Ce cigare du film noir se distingue radicalement de celui des maîtres du pouvoir : il n’exprime plus la domination mais la résignation lucide, l’acceptation stoïque d’un monde sans illusions.
L’identité culturelle latino-américaine
Le cinéma cubain et sud-américain intègre naturellement le cigare comme élément de décor culturel authentique. Dans les films de Tomás Gutiérrez Alea ou plus récemment dans certaines productions de Alejandro González Iñárritu, le cigare retrouve sa dimension artisanale et communautaire. Il redevient objet de partage, de tradition familiale, de résistance culturelle face à l’uniformisation mondiale.
L’univers sophistiqué de l’espionnage
Bien que James Bond soit davantage associé à la cigarette, certaines incarnations du personnage flirtent avec l’univers du cigare. Timothy Dalton et Roger Moore, notamment, utilisent occasionnellement cet accessoire pour signifier l’appartenance de leur personnage à une élite internationale raffinée. Le cigare devient alors passeport diplomatique, signe de reconnaissance entre initiés d’un monde parallèle.
Réalisateurs et cigares : derrière la caméra aussi
Les visionnaires fumeurs
Francis Ford Coppola, grand amateur de cigares, transpose naturellement cette passion dans son langage cinématographique. Dans Apocalypse Now (1979), les cigares ponctuent les moments de tension extrême, créent des bulles de temporalité suspendue au cœur de l’horreur. Le réalisateur utilise la fumée comme un voile entre réalité et cauchemar, entre lucidité et folie.
Orson Welles, fumeur compulsif, intègre le cigare dans sa réflexion sur le pouvoir et la corruption. Dans Citizen Kane (1941), les cigares matérialisent l’ascension puis la chute de Charles Foster Kane, rythmant sa trajectoire d’homme public devenu prisonnier de ses propres ambitions.
Stanley Kubrick, perfectionniste obsessionnel, utilise le cigare comme générateur d’atmosphère contrôlée. Dans Docteur Folamour (1964), les cigares fumés dans la salle de guerre deviennent ironiquement des instruments de civilisation au bord de l’apocalypse nucléaire.
L’esthétique du cigare : lumière, ombre, texture
La fumée comme langage visuel
Le cigare offre aux directeurs de la photographie un matériau visuel d’une richesse exceptionnelle. Sa fumée dense et lente permet de sculpter la lumière, de révéler les faisceaux lumineux, de créer des effets de profondeur et de mystère impossibles à obtenir autrement. Dans le cinéma expressionniste allemand, puis dans le film noir américain, cette fumée devient un pinceau invisible qui peint l’angoisse et l’incertitude.
Temporalité et tension dramatique
Le cigare impose son rythme propre : on ne peut pas l’accélérer, on ne peut pas le brusquer. Cette contrainte temporelle devient un atout narratif majeur. Il ralentit mécaniquement le tempo de la scène, crée des silences chargés de sens, permet aux non-dits de s’épanouir. Dans les scènes de négociation ou de confrontation psychologique, le cigare devient métronome de la tension dramatique.
La gestuelle qu’il impose – couper, allumer, aspirer, contempler la fumée – offre aux acteurs une palette d’expressions subtiles. Chaque geste peut être investi d’une signification particulière : l’hésitation avant l’allumage révèle le doute, la contemplation de la fumée traduit la réflexion profonde, l’écrasement brutal signifie la décision irrévocable.
Une icône toujours vivante
Évolution contemporaine
Si les campagnes anti-tabac ont considérablement réduit la présence du cigare à l’écran, son pouvoir symbolique demeure intact. Les créateurs contemporains l’utilisent avec plus de parcimonie mais non moins d’efficacité, conscients de sa charge émotionnelle et culturelle. Dans les séries télévisées comme Mad Men ou Boardwalk Empire, le cigare retrouve sa fonction de marqueur historique et social, ancrant les personnages dans leur époque tout en révélant leur psychologie.
Nouveaux territoires narratifs
Le jeu vidéo s’empare également de cette symbolique. Des personnages comme Tommy Vercetti dans Grand Theft Auto: Vice City ou Big Boss dans Metal Gear Solid perpétuent la tradition cinématographique du cigare comme marqueur identitaire fort. Ces nouveaux médias démontrent la permanence de cet objet dans l’imaginaire collectif contemporain.
Un langage universel
Au-delà des modes et des préoccupations sanitaires, le cigare conserve au cinéma une fonction narrative irremplaçable. Il demeure l’un des rares objets capables de condenser en un seul symbole des notions aussi complexes que le pouvoir, la transgression, la temporalité, l’identité sociale ou la résistance culturelle.
Dans un monde d’images de plus en plus rapides et fragmentées, le cigare impose sa lenteur contemplative, son exigence de durée, sa capacité à créer de l’intimité dans l’espace public. Il rappelle que le cinéma, au-delà du spectacle, demeure un art du temps et de la profondeur psychologique.
Le cigare au cinéma n’est donc jamais un simple accessoire : c’est un révélateur chimique qui développe les personnalités, un amplificateur dramatique qui intensifie les enjeux, un marqueur temporel qui ancre les récits dans leur époque. Sa fumée continuera longtemps encore à s’élever des écrans, porteuse de tous les mystères de l’âme humaine.
Recent Articles
Une Question?
Got a question? Need more information? Our team is here to help. Contact us and let's stay in touch!


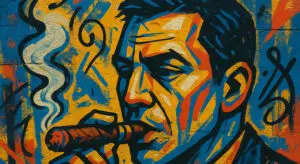
Responses